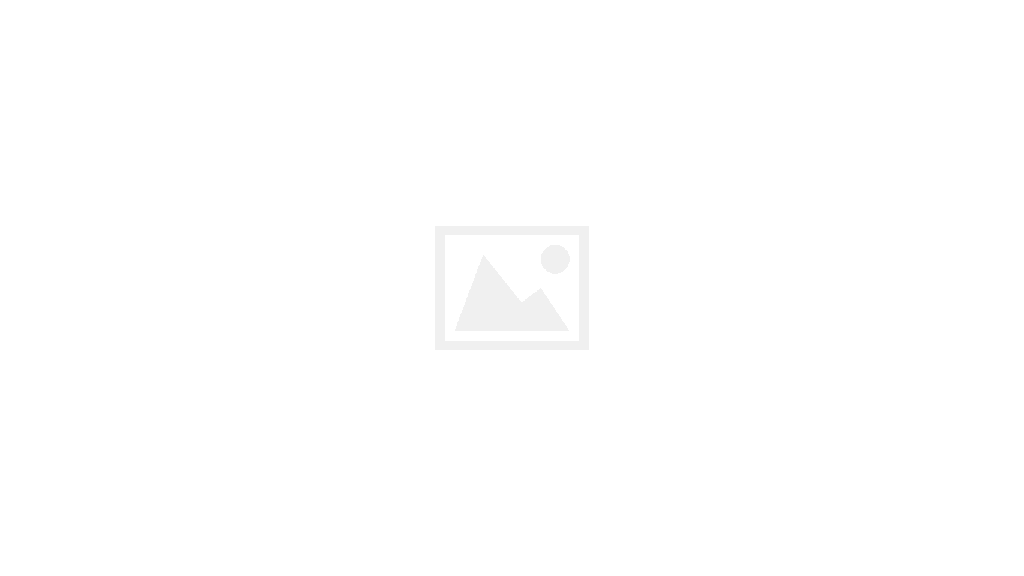J’ai pu participer à la première journée : Agroforum chez Rosier le matin, Ferme du Harby l’après-midi au Pays des Collines.
Comme un médecin, il commence par ausculter le sol : les grands moyens avec la fosse, puis la bêche et enfin le couteau. Nous étions une petite centaine à tendre l’oreille, malgré le froid et le vent, trop heureux d’échapper à la pluie annoncée. C’est la phase « Observation » qui complète la séance « photos » en salle, illustrant l’historique de multiples expériences de terrain vécues antérieurement.
« Réflexion » ou réponse aux questions : Qu’a vécu ce sol, hier, avant-hier ? Cultures et couverts intermédiaires… Travail du sol : un peu, beaucoup, pas du tout ? Et la météo, cette année et les précédentes… Un livre ouvert… qui ne se livre pas toujours facilement.
« Libération » par rapport à quoi ? Aux habitudes ? Aux vieilles recettes ? Aux dogmes idéologiques ? Aux énoncés scientifiques ? Aux diktats réglementaires ? À la désinformation ?
C’est un peu tout cela : privilégier la robustesse à long terme plutôt que la performance à court terme. La robustesse commence au niveau des sols pour amortir les aléas climatiques : trop sec, trop humide. Un mot-clé : le carbone.
En parler, c’est bien. Le fournir, c’est mieux, et pour ce faire, il faut le produire. Directement en maximalisant les couverts : densité, date de semis, choix des espèces, enracinement, incorporation. Indirectement via l’élevage. Et, aussi, faire appel à l’imagination pour s’adapter à chaque situation. Les drones s’invitent pour semer plus tôt.
Et l’azote ? S’il en manque, pas de carbone car pas de croissance de l’engrais vert et/ou compétition entre le végétal et l’activité microbienne du sol qui en a tout autant besoin.
Trop d’azote ? L’enracinement ne fait pas d’effort pour aller le chercher plus loin. Les nodosités boudent les légumineuses.
Bref, le rapport C/N vaut pour le sol comme le rapport Énergie (VEM ou UF) / protéines pour la ration des bêtes.
Comme on a pris conscience que le carbone est devenu le premier facteur limitant, peut-on envisager des apports externes ?
Paradoxalement, les villes qui sont de loin les plus grands élevages d’Europe, ne font rien pour partager leurs effluents. Outre la nourriture, elles sollicitent l’agriculture pour se fournir en énergie renouvelable (biométhanisation), en produits d’isolation (paille), en biocarburants.
Victor Hugo le proclamait déjà en 1862 dans le tome V des Misérables, avec Jean Valjean : « Paris jette par an vingt-cinq millions à l’eau. Et ceci sans métaphore. Comment, et de quelle façon ? Jour et nuit. Dans quel but ? Sans aucun but. Avec quelle pensée ? Sans y penser. Pour quoi faire ? Pour rien. Au moyen de quel organe ? Au moyen de son intestin. Quel est son intestin ? C’est son égout.
On expédie à grands frais des convois de navires afin de récolter au pôle austral la fiente des pétrels et des pingouins, et l’incalculable élément d’opulence qu’on a sous la main, on l’envoie à la mer. Tout l’engrais humain et animal que le monde perd, rendu à la terre au lieu d’être jeté à l’eau, suffirait à nourrir le monde. »
On ne retient de Victor Hugo que ce que l’on veut. Je me suis laissé dire que ce dernier avait remercié les généreux donateurs pour la réfection de « Notre-Dame de Paris » et a proposé de faire pareil pour « Les misérables », où il fait état, précisément, du gaspillage de l’engrais organique parisien.