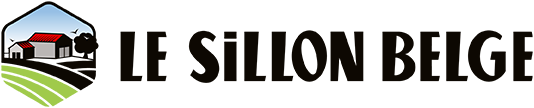En Wallonie, l’ensemble des mesures liées au stockage et à l’épandage des engrais de ferme est intégré au Programme de gestion durable de l’azote (PGDA), transcription régionale de la Directive nitrate européenne. Son principal objectif est de diminuer la pollution des eaux souterraines et de surface par les nitrates d’origine agricole. Pour y parvenir, diverses mesures sont imposées aux agriculteurs et entrepreneurs actifs au Sud du pays.
Stocker ses engrais
Avant d’épandre ses engrais de ferme solides (fumiers, composts et fientes) ou liquides (lisiers et purins), tout agriculteur est confronté à leur stockage et, par conséquent, au respect de certaines exigences.
Ainsi, au champ, le stockage des engrais solides est autorisé mais le tas doit être installé à plus de 20 m de tout point d’eau et à minimum 10 m de celui de l’année précédente. Il ne doit pas être situé dans un point bas du relief, dans une zone inondable ou sur une pente supérieure à 10 %. Les fientes de volailles doivent présenter une teneur en matière sèche (MS) supérieure à 55 % et ne peuvent être stockées plus d’un mois. Les fumiers et compost (d’une teneur en MS supérieure à 55 %) peuvent quant à eux être stockés jusqu’à 10 mois. « En outre, un cahier d’enregistrement reprenant les emplacements et dates de stockage doit être tenu sur l’exploitation pour des raisons de traçabilité », complète Pierre Luxen.
À la ferme, le stockage des engrais solides doit se faire sur une aire bétonné et étanche d’une capacité de stockage de 3 mois minimum. Pour les engrais liquide, la capacité de stockage des cuves étanches est portée à 6 mois minimum. « L’aire de stockage dédiée aux fientes humides (taux de MS inférieur à 35 %) doit quant à elle être couverte », ajoute-t-il.
Tous les éleveurs wallons sont également tenus de disposer d’une Attestation de conformité des infrastructures de stockage (Acisee). Celle-ci devra être renouvelée tous les 5 ans ainsi qu’en cas d’augmentation annuelle de plus de 15 % du cheptel, de modification des stabulations, de changement du type d’animaux élevé, d’une diminution des volumes ou encore de problème d’étanchéité.
Le PGDA impose encore à chaque exploitant de respecter un taux de liaison au sol (LS) inférieur à 1. Celui-ci représente le rapport entre l’azote organique à épandre disponible et l’azote qui peut être valorisé sur l’exploitation. « En d’autres mots, l’agriculteur doit disposer d’une superficie suffisamment grande que pour épandre ses engrais organiques sans risque pour l’environnement. »
Épandre, mais sous quelles conditions ?
L’épandage des engrais de ferme est lui aussi soumis à réglementation, tant au niveau des périodes que des conditions d’épandage.
Pierre Luxen : « Les périodes durant lesquelles l’épandage est autorisé dépendent non seulement du type d’engrais épandu mais aussi de la localisation de la parcelle (en zone vulnérable ou non) et de sa fonction (terre arable ou prairie) ». Les figures ci-dessous présentent les calendriers d’épandage pour les deux types de terres.


Tout épandage d’engrais, qu’il soit organique ou minéral, doit également se conformer aux exigences résumées à la figure ci-dessous auxquelles s’ajoutent quelques conditions supplémentaires.

Ainsi, sur une parcelle de culture présentant une pente supérieure ou égale à 10 % et sise en zone vulnérable, il est interdit d’épandre des engrais minéraux sur une culture sarclée ou assimilée. Cette interdiction est levée si une bande enherbée est implantée en bas de la pente ou si une prairie, une graminée, une jachère faune ou un boisement est présent en bas de la parcelle avant le 3 novembre de l’année précédente. Sur une parcelle de culture qui présente une pente supérieure ou égale à 15 %, seuls des engrais de ferme à action lente (fumier de bovins ou composts, par exemple) peuvent être appliqués sur la partie réellement en pente.
Enfin, l’épandage de lisier sous forme de « gerbe vers le haut » (buse palette non inversée) est interdit depuis le 1er janvier 2015 pour les tonneaux d’une capacité supérieure à 10.000 l.
Implanter une cipan
L’implantation d’une culture intermédiaire piège à nitrate (cipan) après récolte de la culture en place permet de réduire le lessivage des nitrates d’origine agricole.
« Partout en Wallonie, après un épandage de matière organique réalisé entre le 1er juillet et le 15 septembre, une cipan doit être implantée avant le 15 septembre. Sa destruction n’est possible qu’à partir du 15 novembre », détaille Pierre Luxen. Notons que cette cipan peut contenir jusqu’à 50 % maximum de légumineuses (en poids de semences).
En zone vulnérable, l’exploitant doit respecter des règles plus strictes. En effet, 90 % des surfaces récoltées avant le 1er septembre et suivies d’une culture de printemps (c’est-à-dire implantée après le 1er janvier) doivent être couvertes pour le 15 septembre au plus tard. La destruction du couvert est possible à partir du 15 novembre mais celui-ci doit recouvrir un minimum de 75 % de la parcelle au 1er novembre. Ici aussi, il peut être constitué de 50 % maximum de légumineuses (en poids de semences). « Il est bon de savoir que les repousses de céréales sont considérées comme une couverture », précise-t-il encore.
Toujours en zone vulnérable, après une légumineuse récoltée avant le 1er août et suivie d’un froment, il convient de semer un couvert avant le 1er septembre et de le maintenir jusqu’au 1er octobre minimum. Une fois encore, ce couvert peut contenir jusqu’à 50 % maximum de légumineuses (en poids de semences).
En zone vulnérable, surveiller son APL
En zone vulnérable, un suivi de l’azote potentiellement lessivable (APL – quantité d’azote nitrique, en kg N/ha, contenu dans le sol à l’automne et susceptible d’être entraîné hors de la zone racinaire pendant l’hiver) est réalisé chaque année chez 5 % des agriculteurs, tous sélectionnés aléatoirement.
L’APL est déterminé sur base de trois prélèvements réalisés dans leurs parcelles entre le 15 octobre et le 30 novembre, soit avant le drainage hivernal. Les résultats obtenus sont ensuite comparés avec les valeurs de références établies dans 40 fermes wallonnes de référence pour 8 classes de cultures.
Si après analyse, 0 ou 1 APL apparaît comment étant non-conforme, l’évaluation est positive et s’arrête là. A contrario, si 2 ou 3 APL sont déclarés non-conformes, l’agriculteur entre dans un programme d’observation et les mesures d’APL continuent. « L’exploitation sera également considérée comme non-conforme si une des parcelles a un dépassement de 100 % de l’APL de référence et de plus de 100 kg N/ha », ajoute Pierre Luxen. Une fois intégrée dans le programme d’observation, une exploitation ne peut le quitter que si elle est évaluée positivement deux années consécutives. Inversement, si elle cumule trois évaluations négatives, consécutives ou non, elle se verra infliger une amende.
Céder ses engrais de ferme
Enfin, chaque éleveur dispose de la possibilité de céder ses engrais de ferme à un collègue. Tout transfert doit néanmoins faire l’objet d’un contrat d’épandage, lui-même suivi de deux phases de « pré-notification » et de « post-notification ». Ces trois étapes peuvent se faire à l’aide d’un formulaire électronique ou papier.
Le contrat doit être réalisé par le cédant, soit 15 jours avant le transfert s’il fait le choix du formulaire papier à renvoyer à l’administration, soit juste avant le transfert s’il opte pour la voie électronique. La pré-notification est à réaliser également avant le transfert, 2 jours avant pour la voie papier (envoi par fax), à tout moment par voie électronique. Cette charge incombe également au cédant qui doit savoir que le formulaire de transfert n’est valable qu’un jour et uniquement pour un type de matière. Une fois le transfert effectué, le cédant « post-notifie » les quantités réellement transférées à l’administration endéans les 15 jours, par voie papier ou électronique. « Attention, si le délai de post-notification n’est pas respecté, les quantités pré-notifiées seront comptabilisées dans le LS du preneur mais pas chez le cédant », alerte Pierre Luxen.
Une « Bourse d’échange d’engrais de ferme » est aussi disponible sur internet (www.labeef.be). Elle permet aux agriculteurs de trouver les offres et les demandes qui correspondent le plus à leurs besoins en matière d’engrais de ferme, tout en localisant les différentes propositions. Elle facilite également la mise en contact entre le preneur et le cédant afin de réaliser les contrats d’épandages.
Dans le cadre du PGDA, une zone dite vulnérable a été créée en Wallonie afin de protéger les eaux souterraines et les eaux de la mer du Nord des effets néfastes d’une éventuelle mauvaise gestion des engrais azotés. Celle-ci comprend le nord du Sillon Sambre-et-Meuse, le Pays de Herve, le Sud Namurois et une grande partie du Condroz, soit plus de 60 % de la surface agricole utile wallonne.
Au sein de cette zone, des mesures spécifiques viennent s’ajouter à celles déjà prises sur l’ensemble du territoire wallon. Elles concernent notamment le taux de liaison au sol, les périodes et conditions d’épandage, les obligations de couverture des sols et le suivi de l’azote potentiellement lessivable (lire par ailleurs).
De son côté, Pierre Luxen observe que cette zone vulnérable s’étend au fur et à mesure des révisions du PGDA. « Il y a une volonté, à terme, de faire de l’entièreté de la Wallonie une zone vulnérable et, par conséquent, d’y appliquer les mesures spécifiques supplémentaires », constate-t-il.
La destruction des prairies permanentes est possible uniquement entre le 1er
février et le 31 mai, quel que soit le type de destruction (labour, déchaumage, destruction chimique…). Suite à cette action, il est interdit d’épandre de l’azote organique durant les 2 années suivant la destruction et de l’azote minéral durant la première année suivant la destruction. « Et ce, alors que l’azote minéral est plus sensible au lessivage que l’azote organique… », constate Pierre Luxen. Les prairies temporaires ne sont pas concernées par ces mesures.