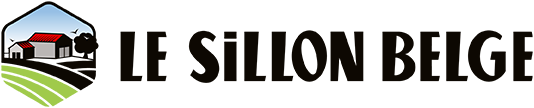Située à Avize, non loin d’Epernay, la Maison champenoise Waris Larmandier, qui allie Art et Champagne, existe depuis près de 30 ans. Avec près de 4ha75 de vignes à disposition, elle s’est tournée depuis près de 8 ans vers la biodynamie. Une petite révolution dans la manière de travailler qui s’est traduite, notamment, par l’arrivée du cheval dans les vignes.
Jean-Philippe Larmandier, revenu en 2009 sur le vignoble, est le principal artisan de ce retour aux sources. Son objectif ? Proposer un champagne naturel ET de haute qualité.

« À travers mes cours d’œnologie, j’ai pu appréhender « l’approche chimique » des vignes. Je me suis rendu compte que nos connaissances sur le sujet sont très limitées, et qu’on navigue en eaux troubles… Raison pour laquelle je suis vite revenu aux bases, vers plus de naturel ! », confie Jean-Philippe
Quand il revient sur le domaine, il ressort directement les vieilles charrues. « Plus personne n’en avait ! J’ai commencé à labourer quelques vignes à l’aide d’un enjambeur et l’année suivante j’ai relevé le défi de passer en Zéro herbicide. »
C’est cette année-là qu’il rencontre Jérôme De Juriew, un prestataire de services qui travaillait avec ses Trait Ardennais pour un autre vigneron. « Quand j’ai vu la nature imposante du cheval de trait, j’ai tout de suite été passionné. Tout ce côté traditionnel qui se réveille, j’aime ça ! »
En 2011, plus aucun désherbant n’est utilisé ! « Tout le monde me prenait pour un fou. C’est aussi à cette époque que Jérôme nous a rejoints pour désherber les vignes à l’aide de ses Trait Ardennais. »
Pour Le vigneron, l’association animal-nature crée une impulsion positive dans les vignes. « J’ai participé à des stages chez de grands puristes de la biodynamie en Champagne, comme Benoît Lahaye. J’ai ensuite relevé le défi de suivre leurs traces l’année suivante. »
Les premières années sont compliquées, faute de matériel : « Je me suis équipé au fur et à mesure. Pour gagner en polyvalence et en précision, je me suis lancé, sur le côté, dans les prestations viticoles. Je ne travaille qu’en biodynamie. »
Si l’idée plaît, une part de scepticisme persiste au sein de ses proches. « L’aspect économique reste compliqué car le retour sur investissement peut-être long. En sachant qu’en Champagne, on stocke parfois des bouteilles 8 ans en cave. On immobilise donc de la main-d’œuvre plusieurs années… Mais avec le recul, j’estime avoir fait les bons choix. »

L’histoire de ce domaine n’est pas un long fleuve tranquille. Il perdra des terres, pour en acquérir ailleurs. « Notre vignoble est morcelé. il faut donc être réaliste, tout n’est pas possible à cheval. Chez nous l’équidé travaille 90 à 95 % de nos terres. Dans les grands crus, nous avons des parcelles de moins de 5 ares. Et ce n’est pas s évident de faire travailler le cheval sur de trop petites parcelles. A contrario, pour un vigneron qui a un domaine compact, le cheval peut-être une évidence. »
Car une parcelle se travaille soit entièrement au cheval soit pas du tout. L’une des difficultés réside dans les variations des conditions météorologiques. « Si l’on passe d’un printemps humide à un temps sec, et que l’on travaille au tracteur, l’on va inévitablement trop tasser les sols. Raison pour laquelle le cheval aura toujours sa place, mais ce n’est pas évident de travailler un sol qui a été travaillé précédemment par du gros machinisme. »
Fermer la boucle agronomique
Le vigneron a beaucoup de satisfaction personnelle à travailler sans produit chimique et de pouvoir fermer un peu plus la boucle agronomique. « J’y gagne surtout en indépendance. Si la charge de travail est plus importante, on le fait aussi pour l’environnement et la qualité de notre produit. »
Le cheval est davantage un outil complémentaire pour le vigneron. Toutefois durant les phases compliquées, il peut être essentiel pour le travail de la vigne.
Mais ce n’est pas tout de travailler différemment il faut pouvoir véhiculer une image positive, au risque de ne pas être pris au sérieux. « L’important c’est se mettre une charge de travail plus importante dans l’intérêt de l’environnement mais aussi de montrer que cela fonctionne, pour que les gens adhèrent à notre façon de travailler. »
Et cela fonctionne puisque bon nombre de vignerons, qui travaillent en bio, intègrent progressivement l’animal dans leurs domaines.

Davantage d’activités à développer…
« En travaillant avec le cheval, on crée de l’emploi indéniablement mais il y a aussi un côté éthique important. On sauvegarde un patrimoine des traditions… Notre façon de travailler a toujours intrigué, provoqué et ça attire, c’est aussi cela qui est intéressant. Et les touristes veulent voir le cheval dans les vignes.
« Si les activités touristiques en calèches se développent, il y a tellement d’autres types animations encore possibles en Champagne… »
Toutefois, les synergies entre vignerons restent modérées. Certains voient davantage le cheval comme un outil commercial : « Ils ne l’utilisent que pour la venue d’un journaliste ! »
Mais aussi des outils…

Et d’y voir aussi de nombreux autres développements autour du travail du cheval, comme de nouveaux outils complémentaires pour accroître la productivité du cheval. « Faut-il encore que des ingénieurs s’intéressent à la profession, se rendent sur le terrain pour observer le cheval et le comparer à la mécanisation actuelle. »
Le Champenois est d’ailleurs persuadé qu’avec des outils mieux pensés, le cheval pourrait être plus compétitif que certaines machines tant certains travaux ne sont pas intéressants d’un point de vue économique et/ou agronomique.
« J’aimerais bien mettre d’autres projets en place mais il faut attendre le retour économique de notre travail. Parce que tout ce dont on parle a un coût et nécessite une organisation particulière ! »
« Plus tard, j’imagine avoir des moutons dans la vigne. Quand on remet les animaux dans leur habitat naturel, une fumure se fait naturellement. A l’automne, dès que les feuilles tombent que les bois sont aoûtés les animaux pourraient tondre naturellement les parcelles et faciliter ainsi le travail des outils de sol.
Mais Jean-Philippe veut aller plus loin. « Pourquoi ne pas adapter la taille de la vigne aux outils… pour éviter aux chevaux de la blesser et avoir également un meilleur rendement… »
Avec cette initiation, le CECT avait pour ambition de faire découvrir non seulement le travail des vignes, mais également une utilisation différente du cheval de trait, une valorisation de l’équidé qui pourrait avoir une place en Belgique. « Nous sommes venus en Champagne car nous connaissons le prestataire et le vigneron. En outre, en Belgique, personne ne travaille les vignes au cheval. Or, c’est une diversification de plus en plus cohérente chez nous. »
Une gestion du cheval différente
Si la période n’était pas propice à faire le plein de stagiaires les participants auront eu deux jours pour s’imprégner du métier.
« Par rapport au débardage, le travail est davantage physique pour l’homme que pour l’animal. Pour obtenir un bon résultat, l’homme doit exercer une pression constante sur la charrue. Et cela se complique quand on monte dans les reliefs », analyse Jean-Claude.
Le plus dur pour le cheval ? « Avoir de l’endurance pour la traction. Il faut un cheval qui avance, qui tire et qui soit volontaire. Il ne doit toutefois pas être forcément intelligent à l’écoute. Il ne reçoit des ordres qu’en bordure de parcelle, lorsqu’il doit changer de ligne. »
Le travail est donc adapté à toutes les races de Trait. « Le cheval est aligné dan son écartement de vigne d’1.10 m et il a 7 m en bout de ligne pour tourner… toutes les races sont adaptées pour ce type de travail. Tout dépend donc de l’affinité du prestataire pour l’une ou l’autre race. À partir du moment où le cheval a le mental pour travailler, ça ne peut qu’aller. »
Et à tout travail, un dressage adéquat. Dans les vignes, si la charrue touche un obstacle, le cheval doit faire l’effort de s’arrêter pour éviter de blesser un pied de vigne tandis qu’en débardage c’est l’inverse.
Un exemple suivi
L’initiative sera certainement reconduite. Nous ne sommes pas les seuls à la proposer puisqu’elle est reprise par le Stud-book des Ardennais Français. Chaque année, ils proposent une activité dans un vignoble différent. C’est intelligent ! Ils valorisent ainsi leurs chevaux sur différents territoires. Et, avec le cheval, c’est la seule façon de montrer ce que l’on a. »
Pour plus de diversification
Après la Foire de Libramont, où le CECT sera au four et au moulin, une initiation en forêt sera proposée car les demandes sont nombreuses ! Mais il ne compte pas s’arrêter là ! « Nous allons nous réorienter vers d’autres utilisations du cheval de trait pour lesquelles il y a un potentiel à développer ! »
Car comme le rappelle Jean-Claude, « le cheval a tout à fait sa place, que ce soit dans les vignes ou ailleurs. Avec les problèmes d’érosion, de tassement de sol, le cheval reste une alternative de choix ! D’autant qu’avec les contraintes dans l’utilisation des produits phytos, on doit arriver à des techniques d’entretien et de traitements beaucoup plus douce », qui conviennent… à l’équidé !
Antoine Rossi est le plus jeune stagiaire (17 ans) venu pour l’initiation. « J’élève des chevaux depuis quelques années, je débarde au bois… J’avais envie d’apprendre une nouvelle façon de travailler. »
Car travailler dans les vignes requiert une tout autre qualification. Et pour trouver du travail au cheval, il se verrait bien créer des débouchés en en débourrant pour les travaux viticoles. « Et pourquoi pas ? Si ça peut sauver le cheval… ».
Il revient sur son expérience : « Le travail est tout à fait différent de ce que nous pratiquons au bois. À la moindre résistance le cheval doit pouvoir s’arrêter pour éviter de blesser le pied. Le cheval réalise davantage un travail d’endurance, qu’un travail de puissance où il faut donner de gros coups de colliers. »
« Si on ne doit pas trop donner d’ordre, il faut pouvoir marcher, suivre le cheval tout en exerçant une pression continue sur le porte-outil… c’est beaucoup plus physique ! mais l’expérience est concluante ! D’autant qu’on travaille en toute convivialité, par groupe et on peut, le cas échéant s’entraider. On ne peut réellement se rendre compte du travail qu’une fois face à l’outil ! »
Jérôme De Juriew, prestataire de services en traction animale, n’est pas un inconnu pour le CECT. Il a en effet déjà participé au concours de traction animale organisé dans le cadre de la Foire de Libramont.
Le trait… et des mules
Passionné par les chevaux depuis tout petit, ce Champenois travaille d’abord comme ouvrier agricole. « Il y a une dizaine d’années, j’ai pu investir dans le cheval et j’ai commencé à travailler avec mes Trait pour un prestataire. »
Avec l’expérience, il se fait connaître. « J’ai continué ma voie seul. Je travaille pour 7 ou 8 clients, essentiellement en bio, et j’entretiens désormais une dizaine d’hectares ».
Jérôme précise : « Pour se vendre, le cheval ne manque pas d’atouts. Si son image joue pour lui, il ne tasse pas le sol et peut aller dans des zones inaccessibles pour des enjambeurs ».
Son choix s’est porté sur les Ardennais : « Je suis champenois, et c’est notre race ! Il n’est d’ailleurs pas rare que je traverse la frontière pour venir chercher des animaux en Belgique. Chez moi, il y a du roulement car je bosse avec des jeunes chevaux. Une fois qu’ils travaillent correctement, je les mets en vente et je recommence avec des nouveaux. J’en ai pour le moment une petite dizaine dont la moitié travaille avec moi. »
Il a d’ailleurs commencé son propre élevage. « J’ai un étalon et une paire de juments que j’ai fait saillir… On verra quels produits j’aurai cette année. Je compte les préparer prépare pour le travail viticole et l’attelage ».
Mais Jérôme travaille également avec des mules car elles sont encore plus légères que le cheval. « Dans les terrains en pente, elles ont davantage de rendement. Avec sa masse, le Trait se fatigue plus vite. »
Combler les vides
« Pour la région, nous devons être une petite dizaine de prestataires viticoles au cheval. Nous avons chacun notre place, nos clients ! »
Mais si Jérôme travaille surtout dans le viticole, il est à la recherche d’autres débouchés. « En Champagne, on travaille par saison. Une fois que notre travail sera terminé fin juillet, on reprendra le boulot à la mi-septembre… et pas pour longtemps ! Avec ce métier, il faudrait pouvoir trouver d’autres débouchés puisqu’on travaille 6 mois par an. Les balades touristiques commencent à prendre de l’ampleur… Je réfléchis aussi à la possibilité de travailler au bois pour combler les creux en hiver. »