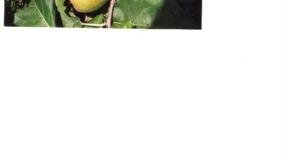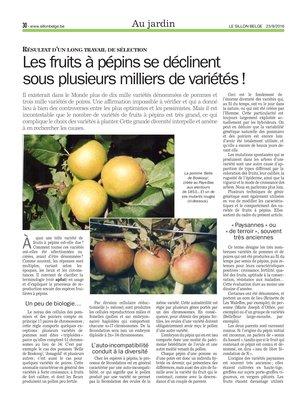Un peu de biologie…
Le noyau des cellules des pommiers et des poiriers compte en principe 17 paires de chromosomes ; cette règle comporte quelques exceptions : plusieurs variétés de pommes sont dites « triploïdes » parce qu’elles comptent 51 chromosomes au lieu de 34. C’est par exemple le cas des pommes ‘Belle de Boskoop’, ‘Jonagold’ et plusieurs autres ; c’est aussi le cas pour quelques variétés de poires. Cette anomalie caractérise en général des variétés à forte croissance, à fruits de fort calibre, et dont les fleurs produisent un pollen peu fertile.
Par division cellulaire réductionnelle (= méiose), sont produites les cellules reproductrices mâles et femelles (pollen et sac embryonnaire) haploïdes qui comportent chacune n=17 chromosomes. De la fécondation sera issu un embryon diploïde à 2n= 34 chromosomes.
L’auto-incompatibilité conduit à la diversité
Ceci est le fondement de l’énorme diversité des variétés qui, au fil du temps, ont vu le jour dans la nature, ou qui ont été créées par l’Homme. Cette particularité est toujours largement exploitée actuellement par les hybrideurs. On peut en déduire que la variabilité génétique naturelle des pommiers et des poiriers est encore loin d’avoir été totalement utilisée, et qu’elle a encore de beaux jours devant elle.
Les mutations spontanées qui se produisent dans les arbres d’une variété sont une autre cause d’apparition de types différant par la coloration des fruits, leur calibre, la rugosité de l’épiderme, ainsi que la vigueur et le mode de croissance des arbres. Nous en parlerons plus loin.
Plusieurs techniques de génie génétique sont également utilisées en vue de modifier les caractéristiques et le comportement des variétés de fruits à pépins. Elles sortent du cadre du présent article.
« Paysannes » ou « de terroir », souvent très anciennes
Ce terme désigne les très nombreuses variétés de pommes et de poires qui ont été produites au fil du temps par semis de pépins, puis retenues pour leurs caractéristiques positives : croissance, fertilité, qualité des fruits, aptitude à la conservation, résistance aux maladies… Cette évaluation dure au moins une dizaine d’années.
Certaines ont été dénommées, et portent un nom de lieu (Reinette de Les Waleffes, par exemple), de personne (Marie Joseph d’Othée, par exemple) ou d’un groupe de variétés (Bellefleur large-mouche, par exemple).
Les deux parents sont rarement connus. Si l’origine du pépin initial est inconnue, on parlera de « semis du hasard », tandis que si le fruit qui contenait ce pépin est connu et dénommé, on dira « issu de libre fécondation de X ».
L’origine des variétés paysannes est souvent très ancienne ; elles étaient cultivées en haute-tige, greffées sur sujets porte-greffes vigoureux, en vergers pâturés. Les fruits étaient davantage utilisés pour la transformation en cidre, vinaigre, sirop, séchage, et pour divers usages culinaires que pour la consommation comme fruits de table.
La grande longévité des arbres – un siècle pour les pommiers, davantage encore pour les poiriers – a permis à un grand nombre de ces variétés de subsister jusqu’à la première moitié du 20e siècle. À partir de 1975, un important travail de collecte des variétés encore existantes a été entrepris au Centre de recherches agronomiques de Gembloux par Charles Populer. Après évaluation, les plus méritantes sont actuellement diffusées par les pépiniéristes sous la marque « Certifruit R.G.F. – Gembloux ».
Fruits d’émulations et de rivalités
À partir du 18e siècle, la culture de collections fruitières dans des jardins clos a connu en Europe occidentale un succès grandissant ; elle a connu son apogée au 19e siècle puis a décliné au 20e siècle. Elle était le fait de personnages aisés ou fortunés : nobles, militaires, ecclésiastiques, scientifiques, industriels, commerçants… entre lesquels il existait une émulation, voire des rivalités.
Leur énorme travail de création variétale est difficilement imaginable actuellement. En Belgique, il a concerné principalement les variétés de poires, tandis qu’au Royaume-Uni, il portait davantage sur les pommes.
À titre d’exemple, en un siècle, la ville de Jodoigne a compté une douzaine de créateurs de variétés actifs entre 1788 et 1880. Les « Annales de pomologie belge et étrangère » publiées à Bruxelles entre 1853 et 1860, et le « Dictionnaire de pomologie » d’André Leroy, en 6 volumes, publié à Angers de 1867 à 1879 sont d’autres témoins de cette activité foisonnante.
Il faut remarquer que le travail des amateurs consiste principalement en croisements dirigés, à une époque où les lois de la génétique n’avaient pas encore été diffusées, et où les notions de gènes dominants et de gènes récessifs n’étaient pas définies, mais grâce à l’expérience acquise au fil du temps, la plus ou moins bonne transmission de caractères à la descendance avait été observée.
Répondre aux objectifs définis
L’amélioration scientifique débute au 20e siècle et se développera avec les progrès de la génétique. L’amélioration des arbres fruitiers à pépins est par nature un processus lent. En effet, après le semis de pépins, il faut attendre 3 à 5 ans l’arrivée des premiers fruits, et il faudra observer le comportement des arbres et les fruits pendant au moins 5 ans avant de faire un jugement valable. Et dans le cas où le schéma de travail suppose plusieurs croisements successifs, il durera au total autant de fois 3 à 5 ans, laps de temps pendant lequel il faut cultiver et observer des milliers d’arbres.
Sélectionner les mutations
Dans l’avenir
Wépion