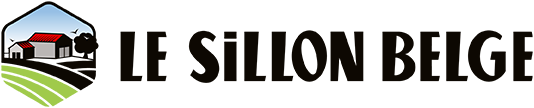Une base méthodologique française
Plusieurs groupes de recherche au Royaume-Uni, en Autriche et en France ont déjà travaillé sur une méthodologie permettant d’évaluer scientifiquement la concurrence pour les protéines végétales entre les animaux et les humains.
Carolien De Cuyper, experte animaux et alimentation animale auprès de l’Ilvo : « Dans notre profession, le calcul de l’efficacité protéique brute est bien connu. Là, nous posons la question suivante : quelle quantité de protéines est produite par les animaux par rapport à la quantité de protéines qu’ils consomment ? Toutefois, les animaux d’élevage peuvent avoir dans leurs rations à la fois des protéines végétales qu’ils ne peuvent que digérer, et des protéines végétales qui peuvent également se retrouver dans l’alimentation humaine (directement ou après transformation). Le calcul de l’efficacité des protéines comestibles est une approche innovante qui calcule précisément la concurrence entre les animaux et les humains en matière de protéines comestibles. »
Dans le cadre de cette étude, l’Ilvo a déterminé, pour les systèmes de production animale les plus courants en Belgique (porcs, poules pondeuses, poulets de chair, bovins laitiers et bovins de boucherie), les quantités de protéines comestibles utilisées par les animaux (sur la base de la composition des aliments) et les quantités de protéines comestibles qu’ils produisent (leur production totale sous forme de lait, d’œufs et de viande). Pour les apports, les chercheurs ont travaillé sur la base de la composition des aliments. Pour la détermination de la teneur en protéines comestibles de chacune des différentes matières premières, ils se sont appuyés sur une étude française qui avait précédemment répertorié les pourcentages de protéines comestibles pour l’homme par ingrédient d’aliments pour animaux.
« Ensuite, pour chaque système de production, nous avons pu déterminer le rapport entre les protéines animales comestibles produites par l’homme et celles consommées par les animaux et obtenir ainsi l’efficacité des protéines comestibles par espèce animale et par système d’ali
– L’étude ne porte que sur un seul aspect de la durabilité. Il existe de nombreux autres paramètres importants et influents tels que les émissions entériques, l’utilisation des sols, le piégeage du carbone, la valeur des effluents d’élevage… qui doivent être pris en compte afin de dresser un tableau plus complet de la durabilité de l’élevage ;
– les résultats finaux de cette étude constituent une estimation approximative, en ce sens que la qualité nutritionnelle finale des protéines importées et exportées n’a pas été évaluée. Les nutritionnistes savent cependant que les protéines végétales et animales ne sont pas totalement équivalentes. Les protéines végétales ont un profil d’acides aminés limité pour l’homme et contiennent parfois des éléments antinutritionnels. Les protéines animales (lait, œufs, viande) sont plus digestes et absorbables pour l’homme et contiennent tous les acides aminés essentiels ;
– la teneur en protéines comestibles du blé a fait l’objet d’une réflexion approfondie dans cette étude. L’étude française part du principe que le blé est de qualité boulangère. Or, le blé utilisé pour nourrir les animaux d’élevage ne répond pas à cette norme. Katrien D’hooghe : « Nous avons donc apporté une nuance dans la nature concurrentielle du blé fourrager. C’est le blé fourrager qui est utilisé, et non le blé boulanger, dans les rations alimentaires des bovins belges. L’industrie alimentaire considère que le blé fourrager n’est pas transformable pour la consommation humaine. Nous avons demandé de calculer l’hypothèse suivante : Si vous deviez calculer le score d’efficacité des protéines comestibles avec la teneur en protéines comestibles du blé fourrager (c’est-à-dire un coefficient adapté à la Belgique), que se passerait-il ? Il apparaît que l’efficacité des protéines comestibles est alors de 1,36 pour les porcs à l’engrais, de 0,96 pour les poulets de chair et de 1,30 pour les poules pondeuses. Les porcs et les volailles sont alors des producteurs nets de protéines comestibles. C’est moins le cas pour les bovins, car les céréales ne jouent pas un rôle important dans les rations des bovins » ;
– « Nous avons fait faire un autre calcul pour inclure le facteur « petit-lait ». Dans les rations bovines, on utilise chez nous un sous-produit du secteur laitier, source de protéines animales et matière première importante de l’alimentation animale qui ne figurait pas sur la liste des matières premières protéiques végétales en France (ndlr : ce sous-produit est appelé poudre de lactosérum et poudre de lait écrémé de qualité alimentaire, qui ne sont pas utilisés pour la consommation humaine). Après cette révision, l’efficacité protéique comestible des bovins laitiers en rations intensives de maïs, en rations intensives d’herbe et en rations extensives passe respectivement à 1,26, 1,81 et 3,59, et celle des bovins à viande à 1,72 et 1,09.
Maximiser l’utilisation des co-produits
Pour Katrien D’hooghe, cette étude confirme que le choix des matières premières et la valorisation de la teneur en protéines comestibles déterminent fortement le rendement en protéines comestibles des bovins belges. Cela nous conforte dans notre conviction que nous devons maximiser l’utilisation des co-produits de la production alimentaire et des biocarburants. De cette façon, nous maximisons nos efforts pour parvenir à un système de production circulaire. Après tout, nous ne pouvons pas manger nous-mêmes des produits tels que la pulpe de betterave, les drêches de brasserie, etc. Actuellement, 43 % de nos matières premières sont des co-produits de ce type. D’ici 2030, ce chiffre devrait être de 50 %. Nous poursuivons également notre recherche de protéines alternatives, telles que les pois, les fèves et les insectes. En veillant tout particulièrement à éviter la concurrence entre les protéines destinées à l’alimentation animale et les protéines destinées à l’alimentation humaine. Pour la première fois, nous en avons une image très claire ! »